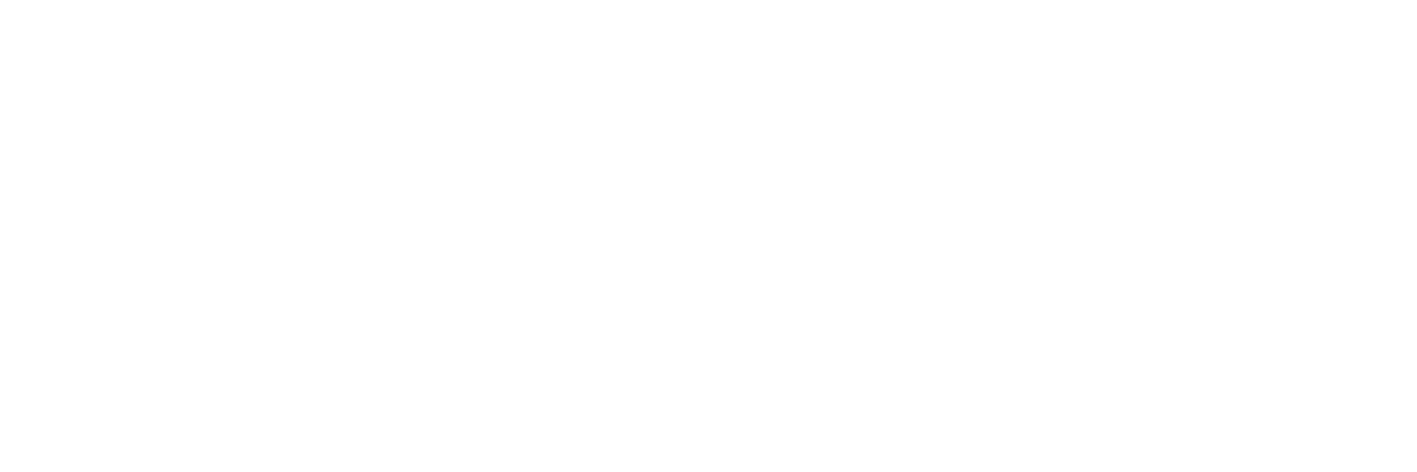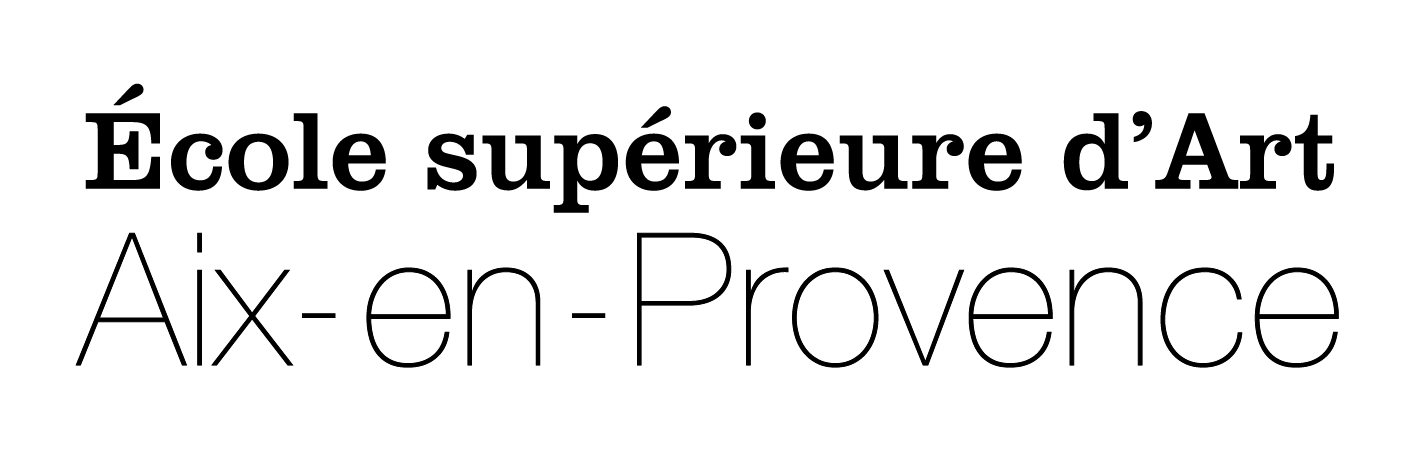A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les dernières notices... |
Détail de l'éditeur
Documents disponibles chez cet éditeur


 Affiner la recherche
Affiner la recherchePour l'intersectionnalité / Éléonore Lépinard
Titre : Pour l'intersectionnalité Type de document : texte imprimé Auteurs : Éléonore Lépinard (1976-....), Auteur ; Sarah Mazouz, Auteur Autre Editeur : Paris [France] : Anamosa Année de publication : 2021 Importance : 1 vol. (69 p.) Format : 13 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-38191-026-0 Note générale : Version revue, actualisée et augmentée d'un article paru en février 2019 dans le dossier Intersectionnalité de la revue "Mouvements"
Bibliogr. p. 67Langues : Français Catégories : Discrimination
Domination
SociologieRésumé : « L'intersectionnalité possède un souffle critique à même d'animer les sciences sociales. À rebours d'une sociologie d'expertise surspécialisée et courant le risque d'être socialement hors sujet, elle donne à voir et à comprendre des expériences de marginalisation et d'oppression ; elle permet d'analyser comment les forces qui structurent nos sociétés de façon hiérarchique ? capitalisme, patriarcat, hétéronationalisme, xénophobie ? s'imbriquent et se renforcent mutuellement. Née dans le chaudron des luttes sociales, l'intersectionnalité nourrit la démarche contre-hégémonique des sciences sociales. » Éléonore Lépinard & Sarah Mazouz Éléonore Lépinard est sociologue, professeure en études de genre à l'Université de Lausanne. Sarah Mazouz est sociologue, chargée de recherches au CNRS. Ses travaux mobilisent notamment les critical race studies.
[4e de couv.]Pour l'intersectionnalité [texte imprimé] / Éléonore Lépinard (1976-....), Auteur ; Sarah Mazouz, Auteur . - Paris (12 rue de Cotte, 75012, France) : Anamosa, 2021 . - 1 vol. (69 p.) ; 13 cm.
ISBN : 978-2-38191-026-0
Version revue, actualisée et augmentée d'un article paru en février 2019 dans le dossier Intersectionnalité de la revue "Mouvements"
Bibliogr. p. 67
Langues : Français
Catégories : Discrimination
Domination
SociologieRésumé : « L'intersectionnalité possède un souffle critique à même d'animer les sciences sociales. À rebours d'une sociologie d'expertise surspécialisée et courant le risque d'être socialement hors sujet, elle donne à voir et à comprendre des expériences de marginalisation et d'oppression ; elle permet d'analyser comment les forces qui structurent nos sociétés de façon hiérarchique ? capitalisme, patriarcat, hétéronationalisme, xénophobie ? s'imbriquent et se renforcent mutuellement. Née dans le chaudron des luttes sociales, l'intersectionnalité nourrit la démarche contre-hégémonique des sciences sociales. » Éléonore Lépinard & Sarah Mazouz Éléonore Lépinard est sociologue, professeure en études de genre à l'Université de Lausanne. Sarah Mazouz est sociologue, chargée de recherches au CNRS. Ses travaux mobilisent notamment les critical race studies.
[4e de couv.]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 019594 305.8 LEP Livre Médiathèque Fonds général Disponible VIH/SIDA / Stéphane Abriol
Titre : VIH/SIDA : l'épidémie n'est pas finie Type de document : texte imprimé Auteurs : Stéphane Abriol ; Christophe Broqua ; Renaud Chantraine ; Caroline Chenu ; Vincent Douris Editeur : Paris [France] : Anamosa Année de publication : 2021 Autre Editeur : Marseille : MuCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée Importance : 1 vol. (304 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-38191-043-7 Langues : Français Catégories : Act Up-New York
Act up-Paris
Militantisme
Mouvements de lutte contre le sida
SidaRésumé : Quarante ans et 36 millions de morts après sa découverte, le VIH circule encore. Si les traitements antirétroviraux permettent désormais de vivre avec la maladie, on compte toujours près d'un million de décès chaque année dans le monde. L'apparition du sida et sa propagation dans les sociétés contemporaines ont provoqué des bouleversements intimes et sociaux, révélé des fractures et suscité des luttes historiques. Notre société porte les héritages de celles-ci, mais aussi les persistances des disparités engendrées ou révélées par le VIH/sida. Les luttes se poursuivent, pour briser le silence, éviter les nouvelles contaminations et réduire les inégalités, notamment en termes d'accès aux traitements. Retraçant son histoire sociale, l'exposition « VIH/sida : l'épidémie n'est pas finie ! » et ce livre qui s'en fait l'écho s'appuient sur l'important fonds d'objets et d'archives du Mucem, constitué dans les années 2000 par le biais d'une enquête ethnographique qui a permis la collecte de nombreuses traces des luttes, en France, en Europe et en Méditerranée. Le projet a été conçu en étroite collaboration avec des personnes vivant avec le VIH, des militant·es, des soignant·es et des chercheurs·euses. Ce livre articule ainsi une histoire subjective de l'épidémie avec plusieurs récits de la collecte, permettant un dialogue entre le point de vue des acteurs·trices et celui du musée. Il a l'ambition de dresser un bilan des conséquences sociales de l'épidémie et des luttes qui lui sont opposées, pour inscrire cette histoire dans un cadre patrimonial et questionner la place de son héritage. Toutefois, loin d'enfermer le sida au musée, il s'agit aussi d'alerter : cette épidémie n'est finie. [4e de couv.] VIH/SIDA : l'épidémie n'est pas finie [texte imprimé] / Stéphane Abriol ; Christophe Broqua ; Renaud Chantraine ; Caroline Chenu ; Vincent Douris . - Paris (12 rue de Cotte, 75012, France) : Anamosa : Marseille : MuCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, 2021 . - 1 vol. (304 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-38191-043-7
Langues : Français
Catégories : Act Up-New York
Act up-Paris
Militantisme
Mouvements de lutte contre le sida
SidaRésumé : Quarante ans et 36 millions de morts après sa découverte, le VIH circule encore. Si les traitements antirétroviraux permettent désormais de vivre avec la maladie, on compte toujours près d'un million de décès chaque année dans le monde. L'apparition du sida et sa propagation dans les sociétés contemporaines ont provoqué des bouleversements intimes et sociaux, révélé des fractures et suscité des luttes historiques. Notre société porte les héritages de celles-ci, mais aussi les persistances des disparités engendrées ou révélées par le VIH/sida. Les luttes se poursuivent, pour briser le silence, éviter les nouvelles contaminations et réduire les inégalités, notamment en termes d'accès aux traitements. Retraçant son histoire sociale, l'exposition « VIH/sida : l'épidémie n'est pas finie ! » et ce livre qui s'en fait l'écho s'appuient sur l'important fonds d'objets et d'archives du Mucem, constitué dans les années 2000 par le biais d'une enquête ethnographique qui a permis la collecte de nombreuses traces des luttes, en France, en Europe et en Méditerranée. Le projet a été conçu en étroite collaboration avec des personnes vivant avec le VIH, des militant·es, des soignant·es et des chercheurs·euses. Ce livre articule ainsi une histoire subjective de l'épidémie avec plusieurs récits de la collecte, permettant un dialogue entre le point de vue des acteurs·trices et celui du musée. Il a l'ambition de dresser un bilan des conséquences sociales de l'épidémie et des luttes qui lui sont opposées, pour inscrire cette histoire dans un cadre patrimonial et questionner la place de son héritage. Toutefois, loin d'enfermer le sida au musée, il s'agit aussi d'alerter : cette épidémie n'est finie. [4e de couv.] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 020030 707.4 MUC 2021 Livre Médiathèque Fonds général Disponible Nature / Baptiste Lanaspeze
Titre : Nature Type de document : texte imprimé Auteurs : Baptiste Lanaspeze, Auteur Editeur : Paris [France] : Anamosa Année de publication : 2022 Collection : Le mot est faible Importance : 1 vol. (101 p.) Format : 19 cm ISBN/ISSN/EAN : 979-10-95772-90-3 Langues : Français Catégories : Ecologie
Nature
Philosophie
Philosophie de l'environnementRésumé : En redéfinissant la nature comme la société des vivants, les pensées de l’écologie nous invitent à penser nos organisations sociales non pas comme une prérogative spécifiquement humaine, mais comme des prolongements des sociétés animales et végétale. Nos sociétés humaines ne transcendent pas les autres sociétés terrestres, mais y sont intégrées, elles en découlent, et elles lui sont redevables. Tout en s’adossant à l’idée d’un sens ancien de la nature comme « monde vivant dont nous faisons partie », il s’agit cependant ici de « recharger » l’idée de nature par les avancées des pensées écoféministes et décoloniales. Il s’agit même d’un enjeu majeur pour l’auteur : « une lutte écologiste conséquente est nécessairement décoloniale ; et inversement ». Nature [texte imprimé] / Baptiste Lanaspeze, Auteur . - Paris (12 rue de Cotte, 75012, France) : Anamosa, 2022 . - 1 vol. (101 p.) ; 19 cm. - (Le mot est faible) .
ISBN : 979-10-95772-90-3
Langues : Français
Catégories : Ecologie
Nature
Philosophie
Philosophie de l'environnementRésumé : En redéfinissant la nature comme la société des vivants, les pensées de l’écologie nous invitent à penser nos organisations sociales non pas comme une prérogative spécifiquement humaine, mais comme des prolongements des sociétés animales et végétale. Nos sociétés humaines ne transcendent pas les autres sociétés terrestres, mais y sont intégrées, elles en découlent, et elles lui sont redevables. Tout en s’adossant à l’idée d’un sens ancien de la nature comme « monde vivant dont nous faisons partie », il s’agit cependant ici de « recharger » l’idée de nature par les avancées des pensées écoféministes et décoloniales. Il s’agit même d’un enjeu majeur pour l’auteur : « une lutte écologiste conséquente est nécessairement décoloniale ; et inversement ». Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 020834 304.2 LAN Livre Médiathèque Fonds général Disponible Revenir / Giulia Fabbiano
Titre : Revenir : expériences du retour en Méditerranée Type de document : texte imprimé Auteurs : Giulia Fabbiano, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Camille Faucourt, Directeur de publication, rédacteur en chef Autre Editeur : Paris [France] : Anamosa Année de publication : 2024 Importance : 1 vol. (142 p.) Présentation : ill. en coul. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-38191-106-9 Prix : 28 EUR Note générale : Exposition ayant eu lieu au Mucem du 18 octobre 2024 au 16 mars 2025.
Langues : Français Catégories : Algérie
Catalogues d'exposition
Cisjordanie (Palestine)
Émigration et immigration
Galilée (Israël)
Grèce
Italie
Liban
Macédoine du Nord (République)
Méditerranée (région)
Migration de retour
SyrieRésumé : Désir, rêve, acte, mythe, horizon possible ou impensable : revenir est une expérience à la fois intime, collective et politique. Elle fabrique des récits de lieux investis ou réinvestis, des lieux vécus, perdus, retrouvés, interdits, occupés, parfois disparus ; des récits de situations migratoires qui se déploient dans l'espace méditerranéen contemporain, connectant ou séparant ses rives. Réinstallations, vacances au pays, tourisme des racines, mobilisations pour le droit au retour, contournements des frontières ou encore rapatriements post-mortem, les pratiques du revenir témoignent toutes des trajectoires de femmes et d'hommes qui ont dû, volontairement ou sous la contrainte, quitter leur pays et habiter l'exil. Ce livre et l'exposition qu'il accompagne s'emparent de ces fragments de vie. Les textes, oeuvres, objets et documents rassemblés ici nous emmènent en Algérie, Cisjordanie, France, Galilée, Grèce, Italie, Liban, Macédoine du Nord, Syrie. Ils invitent à réfléchir au rapport intime et mémoriel au chez-soi, à parcourir ses territoires, à prendre en compte les multiples formes de sa reconnaissance et les voix de sa transmission, génération après génération. Dirigé par Giulia Fabbiano et Camille Faucourt. Avec les contributions de Dunia Al Dahan, Ariella Aïsha Azoulay, Benji Boyadjian, Adélie Chevée, Aude Fanlo, Sabyl Ghoussoub, Guillaume Javourez, Adoram Schneidleder, Liuba Scudieri, Pierre Sintès et Marion Slitine. Revenir : expériences du retour en Méditerranée [texte imprimé] / Giulia Fabbiano, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Camille Faucourt, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Paris (12 rue de Cotte, 75012, France) : Anamosa, 2024 . - 1 vol. (142 p.) : ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN : 978-2-38191-106-9 : 28 EUR
Exposition ayant eu lieu au Mucem du 18 octobre 2024 au 16 mars 2025.
Langues : Français
Catégories : Algérie
Catalogues d'exposition
Cisjordanie (Palestine)
Émigration et immigration
Galilée (Israël)
Grèce
Italie
Liban
Macédoine du Nord (République)
Méditerranée (région)
Migration de retour
SyrieRésumé : Désir, rêve, acte, mythe, horizon possible ou impensable : revenir est une expérience à la fois intime, collective et politique. Elle fabrique des récits de lieux investis ou réinvestis, des lieux vécus, perdus, retrouvés, interdits, occupés, parfois disparus ; des récits de situations migratoires qui se déploient dans l'espace méditerranéen contemporain, connectant ou séparant ses rives. Réinstallations, vacances au pays, tourisme des racines, mobilisations pour le droit au retour, contournements des frontières ou encore rapatriements post-mortem, les pratiques du revenir témoignent toutes des trajectoires de femmes et d'hommes qui ont dû, volontairement ou sous la contrainte, quitter leur pays et habiter l'exil. Ce livre et l'exposition qu'il accompagne s'emparent de ces fragments de vie. Les textes, oeuvres, objets et documents rassemblés ici nous emmènent en Algérie, Cisjordanie, France, Galilée, Grèce, Italie, Liban, Macédoine du Nord, Syrie. Ils invitent à réfléchir au rapport intime et mémoriel au chez-soi, à parcourir ses territoires, à prendre en compte les multiples formes de sa reconnaissance et les voix de sa transmission, génération après génération. Dirigé par Giulia Fabbiano et Camille Faucourt. Avec les contributions de Dunia Al Dahan, Ariella Aïsha Azoulay, Benji Boyadjian, Adélie Chevée, Aude Fanlo, Sabyl Ghoussoub, Guillaume Javourez, Adoram Schneidleder, Liuba Scudieri, Pierre Sintès et Marion Slitine. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 022442 304.83 MUC 2024 Catalogue Médiathèque Fonds général Disponible Couper, coller, imprimer / La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains (Nanterre)
Titre : Couper, coller, imprimer : le photomontage politique au XXe siècle ; [exposition, Nanterre, La Contemporaine, du 19 novembre 2025 au 14 mars 2026] Type de document : texte imprimé Auteurs : La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains (Nanterre), Collectivité éditrice ; Max Bonhomme, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Aline Théret (19..-....), Directeur de publication, rédacteur en chef ; Thomas Bertail (1991-....), Auteur ; Joseph Chantier (1983-....), Auteur ; James Horton, Auteur ; Christian Joschke, Auteur ; Michel Lefebvre (1955-....), Auteur ; Fedora Parkmann (1986-....), Auteur Editeur : Paris [France] : Anamosa Année de publication : 2025 Autre Editeur : Nanterre : La contemporaine Importance : 260 p. Présentation : ill. en coul. et en n. et b. Format : 27 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-38191-141-0 Langues : Français Catégories : Arts graphiques
Catalogues d'exposition
Communication en politique
Militantisme
Photomontage
Photomontage -- Aspect politique
PropagandeRésumé : Très richement illustré, ce livre propose un panorama international de l’histoire du photomontage, sur l’ensemble du XXe siècle, en articulant histoire politique et histoire des formes graphiques.
« Couper, coller, imprimer » : tels sont les gestes essentiels, appliqués aux images photographiques, qui délimitent la pratique du photomontage. Ce rapport particulier à l’image, au graphisme et à la matière imprimée a transformé en profondeur les formes de la communication politique au XXe siècle, en donnant la possibilité d’orienter la lecture des photographies, désormais offertes à toutes sortes de manipulations et de combinaisons.
Accompagnant l’exposition éponyme à la Contemporaine, cet ouvrage propose un panorama international du photomontage en articulant histoire politique et histoire des formes graphiques. S’appuyant sur les contributions des meilleurs spécialistes, ce parcours au travers du siècle et de ses grandes luttes politiques nous emmène à la rencontre des constructivistes soviétiques et des figures majeures des années 1920-1930 à l’instar d’El Lissitzky, John Heartfield ou Gustav Klucis, mais aussi de productions moins connues, notamment dans le domaine de la presse alternative et militante, qui va intégrer le répertoire visuel des contre-cultures à la fin des années 1960 et promouvoir le collage comme incarnation de l’éthique do-it–yourself.
Une véritable traversée du XXe siècle par l’image imprimée et le travail des artistes-graphistes. (source éditeur)Couper, coller, imprimer : le photomontage politique au XXe siècle ; [exposition, Nanterre, La Contemporaine, du 19 novembre 2025 au 14 mars 2026] [texte imprimé] / La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains (Nanterre), Collectivité éditrice ; Max Bonhomme, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Aline Théret (19..-....), Directeur de publication, rédacteur en chef ; Thomas Bertail (1991-....), Auteur ; Joseph Chantier (1983-....), Auteur ; James Horton, Auteur ; Christian Joschke, Auteur ; Michel Lefebvre (1955-....), Auteur ; Fedora Parkmann (1986-....), Auteur . - Paris (12 rue de Cotte, 75012, France) : Anamosa : Nanterre : La contemporaine, 2025 . - 260 p. : ill. en coul. et en n. et b. ; 27 cm.
ISBN : 978-2-38191-141-0
Langues : Français
Catégories : Arts graphiques
Catalogues d'exposition
Communication en politique
Militantisme
Photomontage
Photomontage -- Aspect politique
PropagandeRésumé : Très richement illustré, ce livre propose un panorama international de l’histoire du photomontage, sur l’ensemble du XXe siècle, en articulant histoire politique et histoire des formes graphiques.
« Couper, coller, imprimer » : tels sont les gestes essentiels, appliqués aux images photographiques, qui délimitent la pratique du photomontage. Ce rapport particulier à l’image, au graphisme et à la matière imprimée a transformé en profondeur les formes de la communication politique au XXe siècle, en donnant la possibilité d’orienter la lecture des photographies, désormais offertes à toutes sortes de manipulations et de combinaisons.
Accompagnant l’exposition éponyme à la Contemporaine, cet ouvrage propose un panorama international du photomontage en articulant histoire politique et histoire des formes graphiques. S’appuyant sur les contributions des meilleurs spécialistes, ce parcours au travers du siècle et de ses grandes luttes politiques nous emmène à la rencontre des constructivistes soviétiques et des figures majeures des années 1920-1930 à l’instar d’El Lissitzky, John Heartfield ou Gustav Klucis, mais aussi de productions moins connues, notamment dans le domaine de la presse alternative et militante, qui va intégrer le répertoire visuel des contre-cultures à la fin des années 1960 et promouvoir le collage comme incarnation de l’éthique do-it–yourself.
Une véritable traversée du XXe siècle par l’image imprimée et le travail des artistes-graphistes. (source éditeur)Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 023038 770 LAC Livre Médiathèque Fonds général Disponible